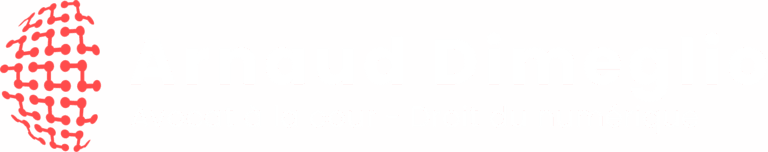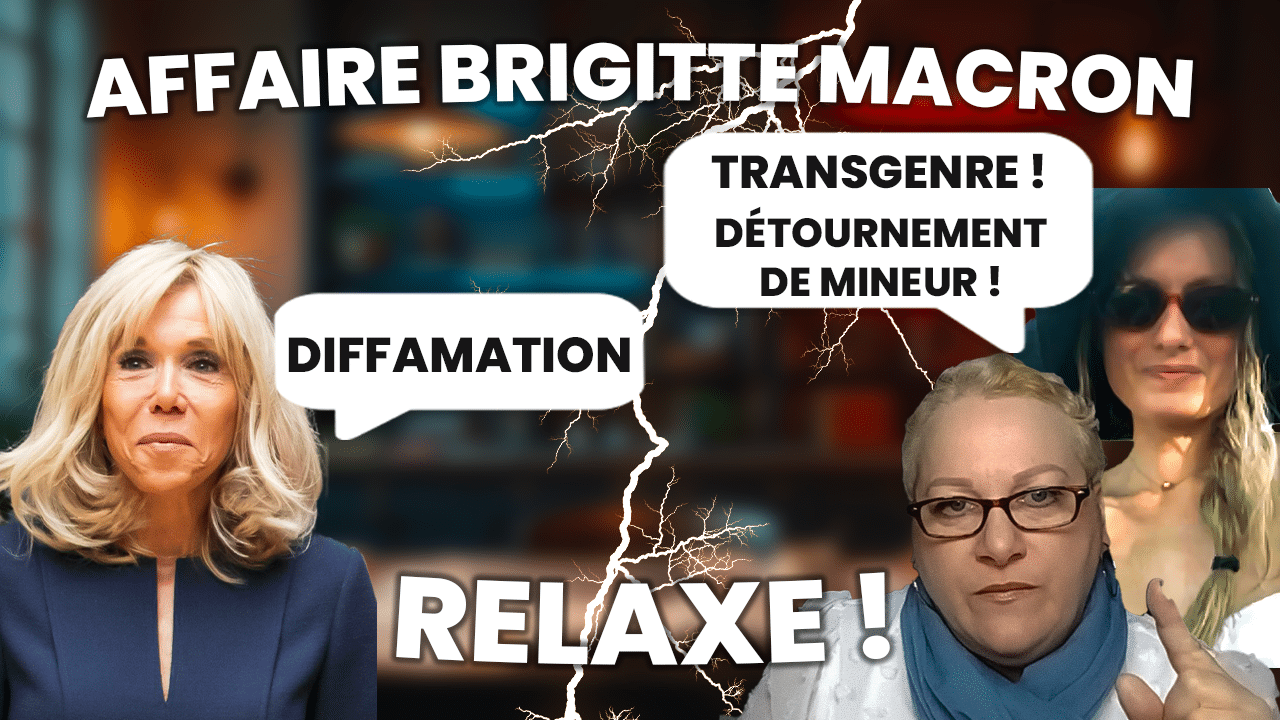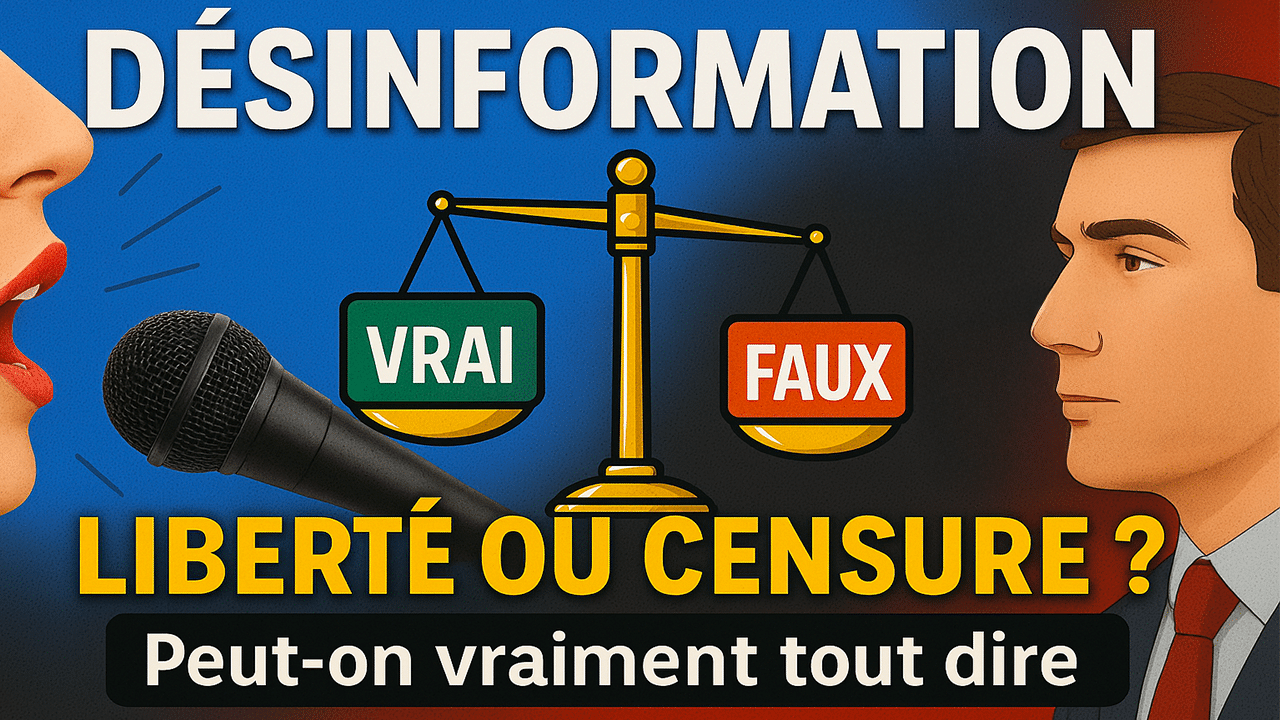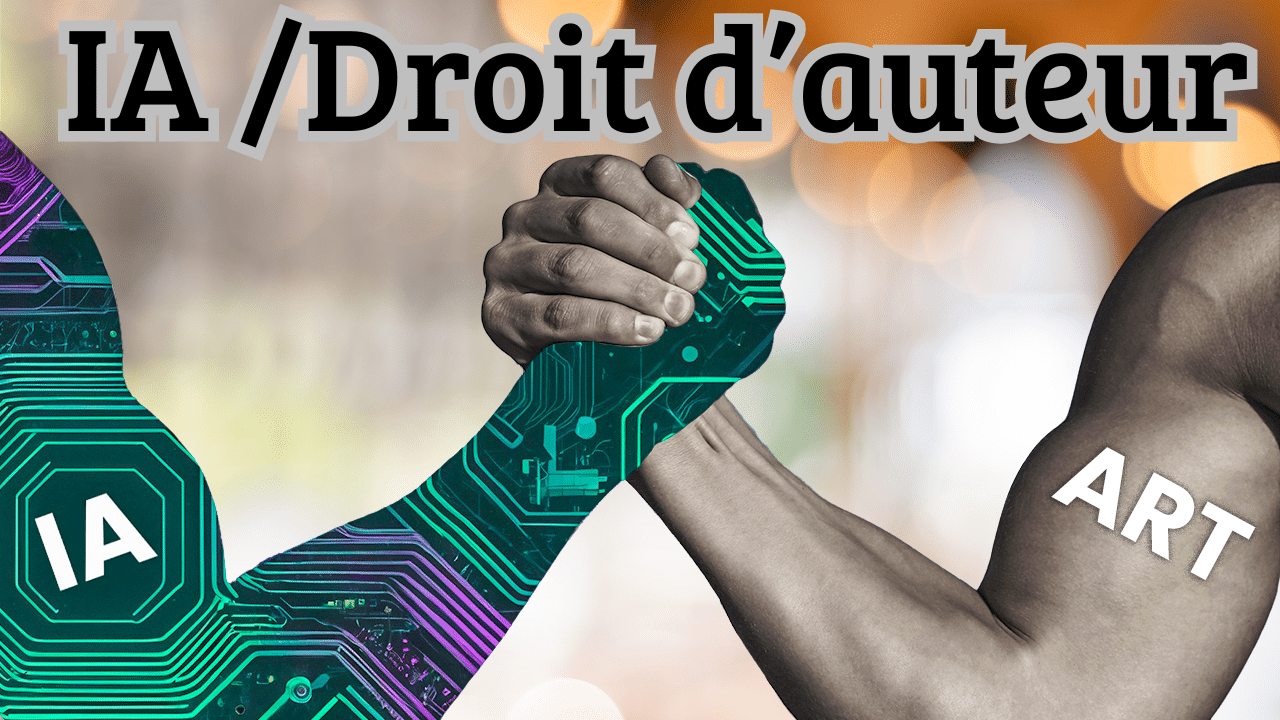La loi du 9 juin 2023[1], modifiée récemment par l’Ordonnance du 6 novembre 2024[2], a créé des obligations pour les influenceurs. Mais cette loi ne doit pas occulter le fait que ces derniers bénéficient, avant tout, de droits et libertés.
Comme tout un chacun, les influenceurs bénéficient de droits et libertés fondamentales dont la liberté de s’exprimer, et de protéger leur réputation.
La liberté d’expression d’un influenceur repose sur le droit de partager ses opinions, idées et contenus sur des plateformes publiques, comme les réseaux sociaux.
En cas de censure par la plateforme, ils bénéficient de droits sur le fondement du Règlement DSA[3]: droit d’être clairement informé de ce qui leur est reproché, et droit de contester la décision prise par la plateforme.
Ils peuvent contester la suppression ou la restriction apportée à leur contenu, soit en agissant en interne contre la plateforme, soit en effectuant une action judiciaire ou extra-judiciaire.
Dans ce cas, il est nécessaire de recourir à un avocat afin qu’il défende au mieux vos intérêts.
La liberté d’expression n’est cependant pas absolue et doit respecter certaines limites, dont le fait de ne pas provoquer ou inciter à la haine.
Un « influenceur» a par exemple été condamné cette année à 12 mois de prison avec sursis pour avoir incité sur Tiktok aux émeutes à Brest après la mort de Nahel.[4]
Il est donc extrêmement important pour les influenceurs de bien connaître la loi applicable à leur activité s’ils ne veulent pas se voir sanctionnés par la plateforme, ou condamnés à de lourdes peines.
- Protection de la réputation
Les influenceurs, en raison de leur notoriété, sont en outre particulièrement exposés aux attaques, et en particulier aux atteintes à leur réputation.
Ils sont régulièrement victimes de diffamation, d’injure, de dénigrement, et peuvent faire l’objet de discrimination et de harcèlement.
Ils disposent néanmoins de droits pour se défendre et peuvent recourir à la justice pour protéger leur réputation et leur sécurité.
L’influenceur Jeremstar a par exemple obtenu la condamnation à de la prison ferme d’un journaliste qui l’avait harcelé sur internet[5].
Il a également obtenu la condamnation d’un autre influenceur (Aquababe) pour diffamation et injure à lui verser la somme de 12 000 euros de dommages et intérêts, et 2 000 euros d’amende[6].
L’affaire Booba contre Magali Berda est un autre exemple frappant d’atteinte à la réputation, et en particulier de cyberharcèlement : Des peines de prison ont été prononcées allant de 4 à 18 mois pour les 28 prévenus condamnés sur le fondement du harcèlement en ligne.[7]
Outre ces attaques, certains influenceurs sont confrontés à des pratiques telles que les deepfakes, utilisées pour manipuler leurs images et tromper leurs communautés.
Heureusement, la loi SREN prévoit des sanctions en cas d’abus[8].
A ce sujet, nous vous renvoyons à notre vidéo consacrée aux DeepFake[9].
D’autres, plus rares, sont victimes de home jacking ou de braquages, en raison de leur visibilité publique.
Enfin certains font l’objet de piratage de leurs comptes via de faux signalements.
Ils peuvent alors agir sur le fondement du code pénal, ou tout simplement en concurrence déloyale s’il s’avère, après identification, que l’attaque provient d’un concurrent.
Afin d’identifier l’auteur de l’infraction, compte de la complexité de la procédure, il est nécessaire de s’adresser à un avocat.
Le préjudice que subissent les influenceurs ne se limite pas au financier : il est aussi moral.
En Italie dernièrement un jeune influenceur s’est suicidé à la suite d’une campagne de cyberharcèlement à son encontre[10].
Les influenceurs peuvent donc être victimes d’infractions, mais ils ont comme tout citoyen des droits pour se faire respecter.
- La loi du 9 juin 2023, modifiée par l’Ordonnance du 6 novembre 2024
La loi du 9 juin 2023 a instauré un cadre juridique précis pour encadrer certaines pratiques des influenceurs, en définissant leurs obligations en matière de transparence et de responsabilité. Afin d’assurer une parfaite conformité avec le droit de l’Union européenne, cette législation vient d’être modifiée par l’Ordonnance du 6 novembre 2024.
Un texte essentiel pour les influenceurs, mais aussi pour les professionnels du droit, qui doivent suivre de près l’évolution de ce secteur en pleine expansion.
- Définition de l’influenceur
Au sens large, l’influenceur, selon le dictionnaire Larousse, est une personne qui, grâce à sa position sociale, sa notoriété ou son exposition médiatique, exerce un pouvoir d’influence sur l’opinion publique.
Au sens strict, la loi du 9 Juin 2023 relative à l’influence commerciale définit l’influenceur comme les « personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique ».
Cette définition soulève plusieurs interrogations.
A quoi fait référence le terme de « notoriété » : Au nombre d’abonnés, de « followers » ? Au taux d’engagement ? Au nom ? Le seul fait d’être rémunéré en promouvant des biens et des services en ligne suffit-il à caractériser la notoriété de l’influenceur ?
De plus, on peut se demander si cette loi s’applique uniquement aux publicités effectuées par les influenceurs ou également à l’influenceur qui fait la promotion de ses propres produits ou services.
Cette définition manque ainsi de précision laissant place à une certaine insécurité juridique.
- Renvoi à la règlementation déjà applicable en matière de publicité
La loi de 2023 renvoi ensuite à la réglementation déjà applicable à la publicité en ligne.
L’article 3 de la loi de 2023 précise en effet que les règles relatives à la publicité et à la promotion des biens et services en ligne s’appliquent également à l’influence commerciale.
Ces règles couvrent plusieurs domaines, tels que les allégations nutritionnelles, la santé publique, les finances, ainsi que le sport.
L’article 4 da loi du 9 Juin 2023 interdit quant à lui la promotion de certains produits ou services par les influenceurs : le tabac, les produits contenant de la nicotine, les abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs, ou encore certains produits financiers à risque pouvant engendrer des pertes importantes comme l’offre de jetons, de bitcoin ou de contrats financiers.
Les promotions impliquant des animaux sont également interdites, sauf lorsqu’elles proviennent des établissements autorisés à en détenir.
Les publicités en ligne pour les jeux d’argent et de hasard sont autorisées uniquement sur des plateformes qui permettent d’exclure les mineurs (moins de 18 ans). Ces publicités doivent inclure une mention claire indiquant cette interdiction.
Quant au domaine médical, l’interdiction de promouvoir des actes, procédés techniques ou méthodes à visée esthétique s’applique uniquement à ceux pouvant présenter un risque pour la santé. De plus, la loi interdit désormais de promouvoir des produits ou pratiques « non thérapeutiques » présentés comme étant aussi efficaces ou même meilleurs que des traitements médicaux reconnus.
Enfin l’article L335-2 et L513-4 Code de la propriété intellectuelle interdit la promotion des produits ou services contrefaits, qu’il s’agisse de vêtements, de cosmétiques, logos etc… La contrefaçon enfreint les droits de propriété intellectuelle, ce qui peut entraîner de lourdes sanctions.
➢ Sanction
En cas de non-respect de ces interdictions publicitaires, l’influenceur encourt une peine de cinq ans d’emprisonnement et une amende de 750 000 euros. L’Ordonnance du 6 novembre 2024 est venue renforcer les sanctions initialement prévues par la loi du 9 juin 2023, qui prévoyait jusque-là une peine de deux ans d’emprisonnement et une amende de 300 000 euros.
- Information – obligation de transparence
L’Ordonnance du 6 novembre 2024 assouplit les règles concernant les mentions obligatoires pour les influenceurs. Avant cette Ordonnance, il était prévu que, lorsqu’un influenceur faisait de la publicité ou une collaboration rémunérée, il devait obligatoirement indiquer les mots « publicité » ou « collaboration » de manière claire et compréhensible.
Avec cette nouvelle ordonnance, l’influenceur peut désormais utiliser une mention équivalente, plus adaptée à son activité et au type de contenu qu’il publie (article 5 de loi). Si cette mention est absente, cela sera considéré comme de la publicité trompeuse (omission commerciale trompeuse, sanctionnée par le Code de la consommation). Cette évolution permet de mieux tenir compte de la diversité des formats utilisés par les influenceurs.
L’Ordonnance facilite aussi l’utilisation des mentions suivantes : « image retouchée » (en cas de modification visant à affiner la silhouette, modifier l’apparence du visage etc…) ; « image virtuelle » (visant à représenter un visage ou une silhouette par intelligence artificielle).
Enfin, lorsqu’un influenceur promeut une formation professionnelle, il doit informer ses abonnés sur le financement, les engagements liés à la formation, ainsi que sur l’identification des prestataires responsables.
Tout cela est mis en place pour protéger les utilisateurs et garantir une transparence dans les pratiques de promotion.
➢ Sanction
En cas de manquement, l’influenceur s’expose désormais à une peine d’un an de prison et à une amende de 4500 euros. Sur ce point, l’Ordonnance du 6 novembre 2024 a assoupli les sanctions relatives aux promotions commerciales qui étaient initialement fixées à deux ans de prison et 300 000 euros d’amende.
L’article 6 de la loi de 2023 régule le recours au drop shipping par des influenceurs. Le dropshipping, ou « livraison directe », désigne un modèle de vente en ligne dans lequel le vendeur se charge uniquement de la commercialisation et de la vente des produits, c’est le fournisseur qui expédie directement les marchandises au consommateur final. En général, le consommateur n’est pas informé de l’existence du fournisseur, ni de son rôle dans le processus (définition du site du gouvernement).
Ledit article prévoit que, en cas de dropshipping, l’influenceur est responsable vis-à-vis de l’acheteur, notamment en ce qui concerne la qualité du produit et la bonne exécution de la transaction.
La loi exige le respect de plusieurs conditions :
Tout d’abord, le produit doit être conforme à la législation française et européenne. Ensuite, l’acheteur doit pouvoir connaître l’identité du fournisseur. Enfin, les informations relatives au produit, telles que le prix, les caractéristiques et les conditions de vente, doivent être clairement affichées.
L’article 7 de la loi de 2023 régule l’activité d’agent d’influenceur. Cela consiste à « représenter, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales qui exercent une activité d’influence commerciale par la voie électronique (voir définition), avec des personnes physiques ou morales et le cas échéant, leurs mandataires, dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque ».
L’article 8 précise qu’un contrat entre un influenceur et son agent doit être rédigé par écrit, sous peine d’être annulé. Il doit inclure des informations essentielles comme l’identité des deux parties, le montant de la rémunération, les missions de l’influenceur et les droits et obligations de chacun. Si des dommages sont causés à des tiers pendant l’exécution du contrat, l’influenceur et son agent seront tous les deux responsables.
L’article 9 de la loi dispose que les influenceurs étrangers (c’est-à-dire ceux qui ne sont pas basés dans l’UE, en Suisse ou dans l’Espace économique européen) doivent désormais désigner un représentant légal et souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle dans l’UE, en Suisse ou dans l’EEE.
Cette règle s’applique aux influenceurs qui ciblent un public en France, même s’ils ne sont pas établis sur le territoire français.
Cela permet de garantir la conformité de leurs contrats au regard du droit français et de répondre aux demandes des autorités.
Un influenceur basé à l’étranger verra ses contenus bloqués s’il ne respecte pas la loi française, notamment sur le caractère commercial de ses publications ou la promotion de produits interdits ou réglementés. Les plateformes sont responsables si elles ne retirent pas ces contenus après en avoir été informées par signalement.
À l’ère où les jeunes sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux, la loi de 2023 encadre les activités des mineurs influenceurs.
Si un influenceur a moins de 18 ans, un contrat écrit avec l’annonceur est obligatoire. Si l’influenceur a moins de 16 ans, il doit obtenir une autorisation administrative en plus du contrat avec l’annonceur pour pouvoir exercer cette activité.
Si une personne de moins de 16 ans exerce une activité d’influenceur, son employeur doit se conformer à la loi du 19 octobre 2020 relative à l’exploitation de l’image des enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne.
Le revenu perçu par le mineur est protégé jusqu’à sa majorité.
L’article 2, 3° de la loi précise que les modalités applicables au contrat entre l’annonceur et le représentant légal du mineur sont identiques à celles régissant la relation entre l’agent de l’influenceur et l’influenceur, comme indiqué à l’article 8.
Cela inclut l’obligation d’établir un contrat écrit, d’y mentionner l’identité des parties, la nature des missions confiées, la rémunération, ainsi que les droits et obligations des parties, la soumission du contrat au droit français.
Les plateformes qui hébergent les contenus des influenceurs sont soumises à une réglementation stricte. Elles doivent permettre aux utilisateurs de signaler facilement tout contenu illicite (via un formulaire) et le retirer rapidement si le signalement est justifié.
Dès lors que les contenus des influenceurs respectent les conditions de la plateforme (CGU) et la loi française, celle-ci n’a aucune raison de les bloquer ou de les limiter. Elle ne peut pas non plus les modifier sans l’accord de l’influenceur. En cas de censure, il est nécessaire de prendre attache avec un avocat afin qu’il défende au mieux vos intérêts.
Les plateformes doivent coopérer activement avec les autorités, ce qui place les influenceurs sous une certaine surveillance, renforçant ainsi le contrôle sur les contenus diffusés.
Il est possible de signaler des contenus trompeurs ou qui ne respectent pas les règles de promotion de certains produits sur le site de la DGCCRF (www.signal.conso.gouv.fr). Des associations appelées « signaleurs de confiance » permettent aussi de signaler des comportements nuisibles en ligne.
En 2023, plus de la moitié des 300 influenceurs contrôlés par la DGGCRF se sont retrouvés en infraction. La peine encourue par les influenceurs varie en fonction de l’infraction : cela peut aller d’une peine d’amende à une peine de prison dans les cas les plus graves.
Par exemple, en 2021, Nabilla a été condamnée à une amende de 20 000 € pour pratiques commerciales trompeuses, en raison de la promotion sur Snapchat d’un site de formation au trading en ligne.
De son côté, Poupette Kenza a écopé d’une amende de 50 000 €, après avoir été reconnue coupable de pratiques commerciales trompeuses. Elle a notamment omis d’indiquer la véritable nature commerciale de certains contenus sponsorisés et a donné l’impression que la vente d’un blanchisseur de dents, interdit en France, était légale.
A titre comparatif, nous sommes loin de l’amende d’1 million de dollars infligée à Kim Kardashian aux États-Unis pour avoir frauduleusement promu une cryptomonnaie, et très éloigné des redressements fiscaux de certains influenceurs, avec des montants pouvant dépasser les 400 000 euros.
Dans le cadre de leurs activités, les influenceurs s’exposent à diverses sanctions, pouvant aller de la fermeture de leur compte à l’obligation d’afficher leur condamnation sur leurs réseaux sociaux, voire au paiement de dommages-intérêts.
Face à ces risques, il est essentiel pour eux de maîtriser les lois qui régissent leur domaine d’activité, afin d’éviter des peines sévères et protéger leur réputation.
Arnaud DIMEGLIO
Avocat à la Cour, Docteur en droit, Titulaire des mentions de spécialisation en droit du numérique, de la communication, et de la propriété intellectuelle. Bureau principal : 8 place St. Côme, 34000 Montpellier, Bureau secondaire : 10 avenue de l’Opéra, 75001 Paris,Tel : 04.99.61.04.69, Fax : 04.84.88.75.81
http://www.dimeglio-avocat.com
[1] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047663185
[2] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050456412
[3] https://www.village-justice.com/articles/reglement-dsa-quels-benefices-risques,47132.html
[4] https://www.lefigaro.fr/faits-divers/mort-de-nahel-un-influenceur-condamne-a-douze-mois-de-prison-avec-sursis-pour-avoir-incite-aux-emeutes-a-brest-20240220
[5] https://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/jeremstar-fait-condamner-un-journaliste-a-de-la-prison-ferme-pour-cyberharcelement_977fd706-d35e-11eb-bb56-c93fd74ea56a
[6] https://www.leparisien.fr/faits-divers/jeremstar-obtient-la-condamnation-du-blogueur-aqababe-pour-diffamation-02-06-2022-EHOY565ZIBEMTNONEWBZQNK3LM.php
[7] https://www.lemonde.fr/pixels/article/2024/03/19/cyber-harcelement-contre-magali-berdah-des-peines-de-prison-allant-de-quatre-a-dix-huit-mois-pour-les-28-prevenus_6222877_4408996.html
[8] https://www.village-justice.com/articles/loi-sren-les-principales-mesures,49487.html
[9] https://youtu.be/4xEBBi3uP_I?si=TBti5JTc0rKXEpd6
[10] https://www.ouest-france.fr/europe/italie/victime-dhomophobie-et-de-depression-un-influenceur-italien-de-21-ans-met-fin-a-ses-jours-dd24fcf0-96ba-11ef-aa5b-49745cfc6671