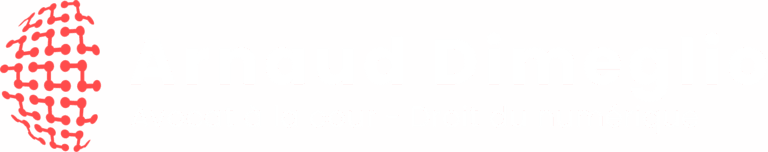Amende de 120 millions d’euros contre X : une première sous le DSA
Le 5 décembre dernier, la Commission européenne a infligé une amende de 120 millions d’euros au réseau social X, anciennement Twitter. Cette décision est historique : c’est la première fois qu’une plateforme est sanctionnée sur le fondement du Digital Services Act (DSA).
Si cette sanction n’est pas totalement surprenante — X étant dans le viseur de la Commission depuis près de deux ans — les griefs retenus, eux, ont déjoué certaines attentes.
Une sanction inattendue dans ses fondements
Beaucoup s’attendaient à une condamnation directe pour manquement aux obligations relatives aux risques systémiques de désinformation. X n’a en effet pas adhéré au Code de conduite contre la désinformation, ce qui laissait présager une sanction sur ce terrain.
Or la Commission européenne a fait un autre choix. X est sanctionnée non pas pour désinformation en tant que telle, mais pour manquements à ses obligations de transparence envers les utilisateurs.
Ces manquements n’en demeurent pas moins étroitement liés aux risques de désinformation. Les trois infractions retenues illustrent cette logique.
Première infraction : les badges bleus et les dark patterns
La première infraction, la plus visible, concerne le système des badges bleus.
À l’origine, ce badge permettait de certifier l’identité d’un compte et de lutter contre les faux profils, les usurpations d’identité et les arnaques. Depuis 2024, à la suite des décisions d’Elon Musk, ce badge peut être obtenu via un simple abonnement payant, sans vérification d’identité.
Ce changement induit l’utilisateur en erreur : un compte peut apparaître comme certifié et fiable alors qu’il s’agit d’un robot ou d’un escroc. Ces faux comptes constituent un vecteur évident de désinformation.
L’article 25 du DSA interdit formellement l’usage d’interfaces trompeuses, également appelées dark patterns. C’est sur ce fondement que repose la première condamnation de X.
Deuxième infraction : l’opacité publicitaire
La deuxième infraction concerne la transparence de la publicité en ligne.
L’article 39 du DSA impose aux plateformes de tenir un registre publicitaire clair et accessible. Les utilisateurs doivent pouvoir savoir :
qui finance une publicité ;
pourquoi elle leur est affichée ;
quel est son contenu exact.
Ces exigences sont essentielles pour détecter les arnaques, mais aussi les campagnes d’ingérence étrangère et les risques de désinformation.
Or le système publicitaire de X a été jugé trop complexe, incomplet et instable, notamment en raison de nombreux dysfonctionnements techniques. La Commission a donc retenu un manquement à l’article 39 du DSA.
Troisième infraction : le verrouillage des données aux chercheurs
La troisième infraction est sans doute la plus directement liée à la désinformation. Elle concerne la violation de l’article 40 du DSA.
Cet article oblige les très grandes plateformes à fournir un accès à leurs données aux chercheurs agréés. L’objectif est de permettre des audits indépendants afin d’identifier l’existence de risques systémiques, notamment en matière de désinformation.
L’enquête de la Commission a révélé que X a multiplié les obstacles techniques et juridiques pour empêcher cet accès. La plateforme interdit notamment le scraping, c’est-à-dire l’extraction automatisée de données par les chercheurs.
Résultat : il est impossible de vérifier de manière indépendante si X présente des risques systémiques de désinformation. C’est pour cette raison que la plateforme est sanctionnée pour violation de l’article 40, sans être condamnée directement pour désinformation.
Une procédure encore en cours
L’amende de 120 millions d’euros ne constitue pas l’aboutissement définitif de la procédure.
X a été mise en demeure de :
corriger son système de badges dans un délai de 60 jours ;
rendre son registre publicitaire pleinement transparent ;
ouvrir l’accès à ses données aux chercheurs dans un délai de 90 jours.
À défaut de mise en conformité, la Commission européenne pourra prononcer de nouvelles sanctions, notamment des astreintes financières journalières.
Une réaction politique et géopolitique virulente
La réaction de X a été particulièrement virulente. La plateforme a d’abord bloqué le compte publicitaire de la Commission européenne. Elon Musk a ensuite qualifié l’amende de « bullshit » et a appelé à la dissolution pure et simple de l’Union européenne, qu’il compare à un régime totalitaire.
Aux États-Unis, certains proches de Donald Trump ont dénoncé une prétendue « taxe sur la liberté d’expression » et évoqué des représailles commerciales contre l’Union européenne.
Un bras de fer qui dépasse le droit
Cette décision dépasse largement le cadre juridique. Elle illustre un bras de fer politique et économique entre l’Union européenne et les États-Unis.
D’un côté, l’Europe cherche à affirmer sa souveraineté numérique et à imposer ses règles aux grandes plateformes. De l’autre, X et une partie de la classe politique américaine contestent frontalement cette régulation.
La stratégie de X contraste d’ailleurs avec celle de TikTok, également sous enquête, mais qui a choisi d’adapter ses pratiques pour éviter une sanction.
D’autres procédures sont en cours, notamment à l’encontre de Meta, ce qui laisse présager que ce type de contentieux est loin d’être terminé.
Conclusion
Avec cette amende, la Commission européenne envoie un signal clair : le Digital Services Act n’est pas un texte symbolique, mais un instrument de régulation effectif.
La question n’est désormais plus de savoir si l’Union européenne utilisera ses nouveaux pouvoirs, mais jusqu’où elle est prête à aller pour imposer ses règles aux géants du numérique.