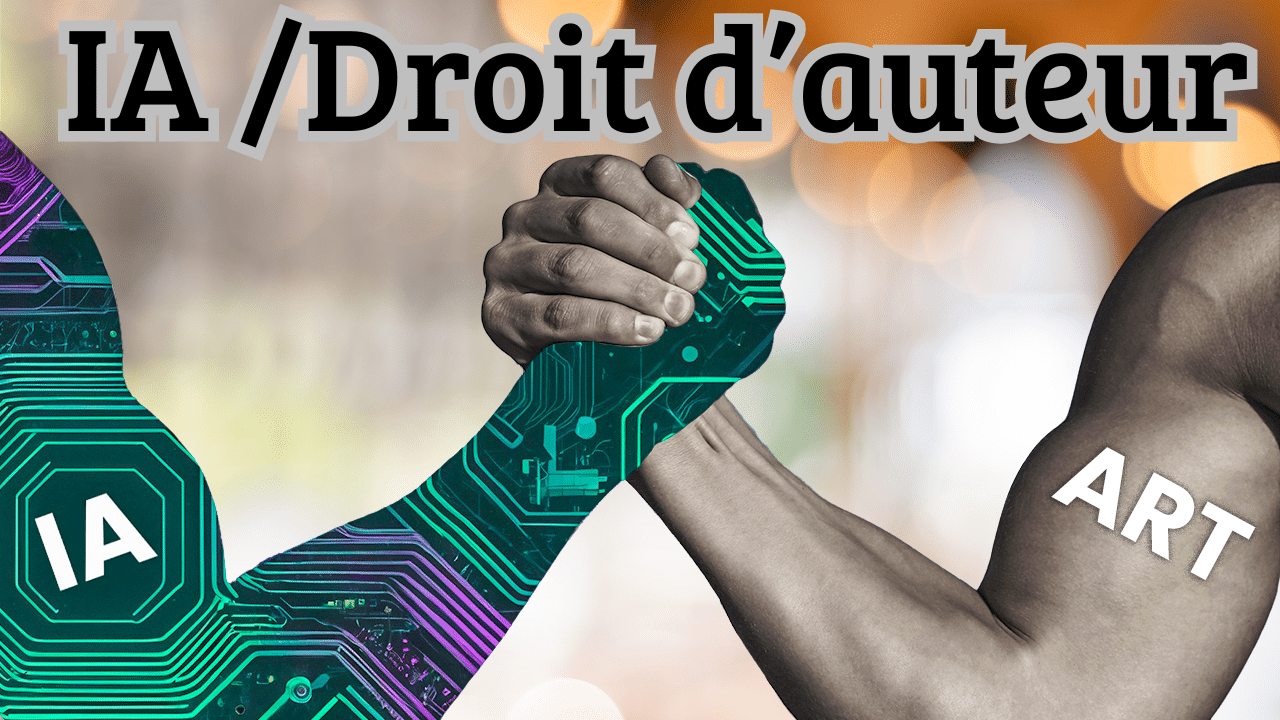LA PROTECTION DES DROITS D'AUTEUR FACE A L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Introduction
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd’hui, nous allons aborder un sujet crucial pour tous les créateurs : la protection des droits d’auteur face à l’intelligence artificielle (IA).
L’IA soulève en effet un véritable défi en matière de droit d’auteur, tant en amont, avec l’utilisation des œuvres protégées pour l’entraînement des modèles, qu’en aval, avec la question de la protection des œuvres générées par l’IA.
L’utilisation des œuvres protégées par l’IA : un enjeu juridique
L’une des grandes questions actuelles est de savoir si les fournisseurs d’intelligence artificielle doivent obtenir l’autorisation des auteurs avant d’utiliser leurs œuvres.
Les fournisseurs d’IA contestent cette obligation en s’appuyant sur certaines exceptions juridiques :
- Aux États-Unis, ils invoquent le fair use, qui permet sous certaines conditions d’utiliser une œuvre protégée sans autorisation.
- En Europe, ils se basent sur l’exception de fouille de textes et de données (text and data mining), qui permet d’analyser automatiquement du contenu numérique.
Cependant, des décisions récentes remettent en cause ces arguments :
- Aux États-Unis, une décision judiciaire a récemment estimé que l’exception de fair use ne s’appliquait pas à l’entraînement des IA sur des œuvres protégées.
- En Europe, bien qu’un tribunal allemand ait jugé que l’exception de fouille de textes et de données pouvait être applicable, cette interprétation reste très contestée.
De nombreux spécialistes estiment que ces exceptions ne s’appliquent pas aux fournisseurs d’IA générative, ce qui pourrait les exposer à des poursuites pour contrefaçon et les contraindre à rémunérer les auteurs.
Peut-on protéger par le droit d’auteur une œuvre créée avec l’IA ?
L’autre grande question concerne la protection des œuvres générées avec l’aide de l’intelligence artificielle. Jusqu’à récemment, la position dominante était que seules les créations réalisées par une personne physique pouvaient bénéficier du droit d’auteur.
Cependant, une évolution notable vient des États-Unis : le Copyright Office a récemment accordé une protection à une image intitulée Single Piece of American Cheese, créée par Ken Kersey grâce à une IA. L’auteur a réussi à prouver son implication substantielle dans le processus de création en filmant son écran, montrant ainsi qu’il avait réellement influencé l’œuvre finale.
Cette décision ouvre la voie à la reconnaissance du droit d’auteur sur des œuvres hybrides, où l’humain joue un rôle actif dans la création assistée par l’IA.
Quelles conséquences pour les créateurs ?
En conclusion, les implications sont doubles :
- En amont, les fournisseurs d’IA risquent d’être tenus responsables pour l’utilisation non autorisée de contenus protégés et devront probablement rémunérer les auteurs.
- En aval, les créateurs qui utilisent l’IA pour concevoir des œuvres originales pourront revendiquer leurs droits et demander une rémunération en cas d’utilisation non autorisée de leurs créations.
Cette rémunération pourra être obtenue :
- À l’amiable, via un contrat avec l’utilisateur de l’œuvre.
- Par voie judiciaire, en cas de litige.
Si vous êtes auteur, vous pouvez donc vous opposer à l’exploitation de vos œuvres par les fournisseurs d’IA. De même, si vous créez avec l’IA, vous pouvez protéger vos œuvres et en contrôler l’utilisation, sous réserve des exceptions classiques du droit d’auteur, comme la copie privée.
Conclusion
Merci d’avoir regardé cette vidéo ! Si elle vous a plu, n’hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. À bientôt pour de nouvelles vidéos !